À l'église Saint-Séverin, les restaurations mettent en valeur des trésors artistiques
Actualité
Mise à jour le 09/07/2025
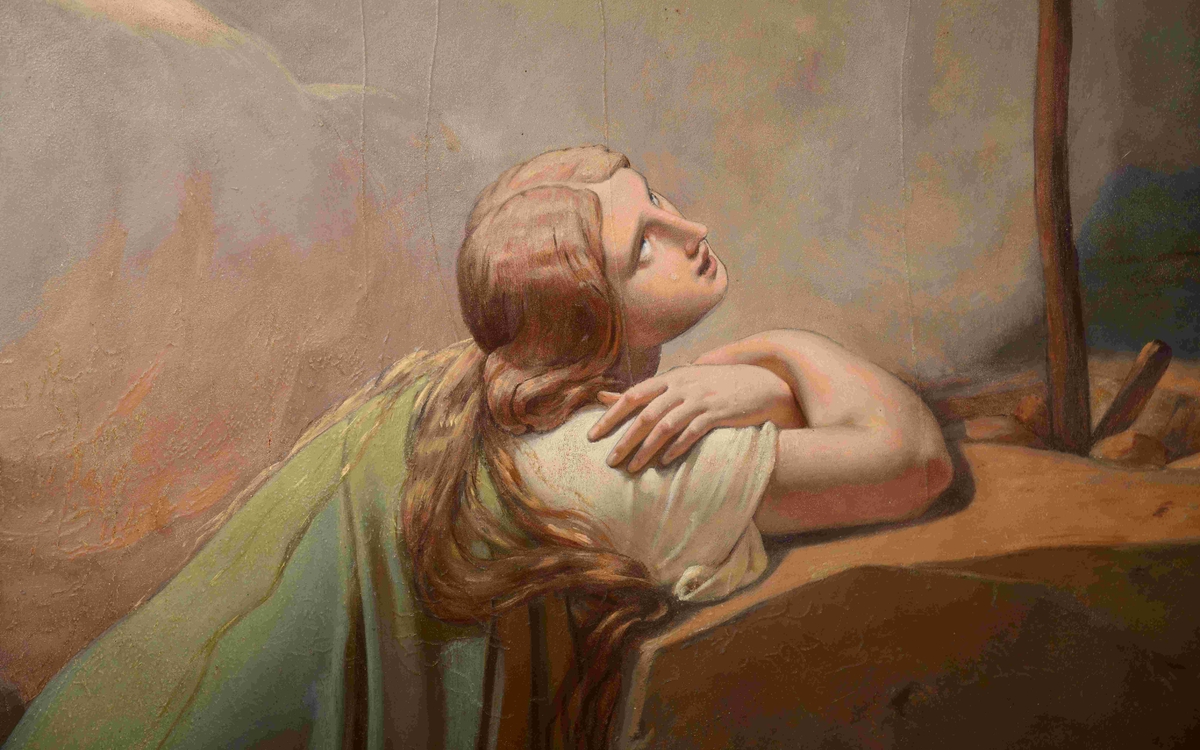
Sommaire
Après la restauration de trois chapelles au début des années 2020, ce sont aujourd'hui les chapelles Saint-Joseph et Sainte-Marie-Madeleine de l’église Saint-Séverin (5e) qui viennent d'être restaurées, permettant la redécouverte et la mise en valeur de nombreux trésors artistiques de l’édifice.

Chapelle Saint-Séverin, Sébastien-Melchior Cornu, Saint-Cloud (détail de saint Séverin le Solitaire remettant l’habit monastique à Saint-Cloud) en cours de restauration et après restauration.
Crédit photo :
Ariel Bertrand

Plafond de la chapelle avant et après restauration.
Crédit photo :
Ariel Bertrand

Vue d'ensemble du mur présentant saint Séverin et Saint-Cloud.
Crédit photo :
Ariel Bertrand

Le soubassement de la chapelle est constitué de motifs décoratifs.
Crédit photo :
Ariel Bertrand
L’église Saint-Séverin, située au cœur du Quartier latin, occupe l’emplacement d’une ancienne chapelle édifiée à l’endroit où, au VIe siècle, l’ermite saint Séverin avait pour habitude de prier ; l’édifice érigé au XIIIe siècle a pris naturellement son nom.
Entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, l’église se dote d’un ensemble de chapelles rayonnantes à son chevet et sur ses bas-côtés. Ce sont ces chapelles qui, entre 1840 et 1865, vont bénéficier d’une grande campagne de décoration et de mise en valeur, réalisée en grande partie par les élèves d'Ingres (1780-1867).
Ces décors peints de l’église Saint-Séverin n’avaient encore jamais fait l’objet d’une restauration globale. Leur état de conservation devenait préoccupant et nécessitait une opération de restauration de grande envergure.
Les opérations de restauration des chapelles Sainte-Geneviève, Saint-Jean, Saint-Séverin, Saint-Joseph et Sainte-Marie-Madeleine ont, outre le Budget Participatif voté par les habitants et le financement de la Ville de Paris, bénéficié du soutien de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, qui a contribué au financement de leur restauration au cours de ces cinq dernières années.
La chapelle Saint-Joseph

Détails de "La Fuite en Égypte" peints par Émile Signol entre 1845 et 1849
Crédit photo :
Crédit photo : Jean-Marc Moser / Ville de Paris

Détails de "Rachel pleurant ses enfants" peints par Émile Signol peints entre 1845 et 1849
Crédit photo :
Crédit photo : Jean-Marc Moser / Ville de Paris

Vitrail d'Emile Hirsch réalisé en 1878
Crédit photo :
Crédit photo : Jean-Marc Moser / Ville de Paris
Emile Signol (1804-1892) reçoit la commande de ce décor en
1845 et il l’achève en 1849. Ses
peintures sont réalisées à l’huile et à la cire sur enduit. Signol réduit le nombre
de personnages et traite leurs visages avec un dessin d’une finesse
remarquable. Douceur et sérénité émanent de ces scènes.
Réalisé en
1878 par Emile Hirsch (1832-1904), peintre-verrier, élève de Delacroix et d'Ingres, le vitrail de la chapelle Saint-Joseph représente la Nativité. Il a été financé et donné par la famille de Jean-Baptiste
Ballière, représenté fidèlement sur le côté droit du vitrail. La technique du
vitrail photographique se développe dans les années 1880. Une observation au
plus près nous a permis de constater que ce portrait est peint et qu’il ne
s’agit pas ici de cette technique singulière qui consiste à développer une photographie
sur le verre cuit à plus de 600°.
Cette chapelle a
ainsi bénéficié d'un nettoyage approfondi des peintures dévoilant des couleurs plus franches et une très belle qualité
d’exécution. Le vitrail a été nettoyé face interne et externe et les
ferronneries traitées. Les parties
sculptées (barrière de communion, ex-voto, sous-bassement) ont aussi fait l’objet d’une
attention particulière. L’ensemble du décor a pu bénéficier d'un nouvel
éclairage.
La chapelle Sainte-Marie-Madeleine
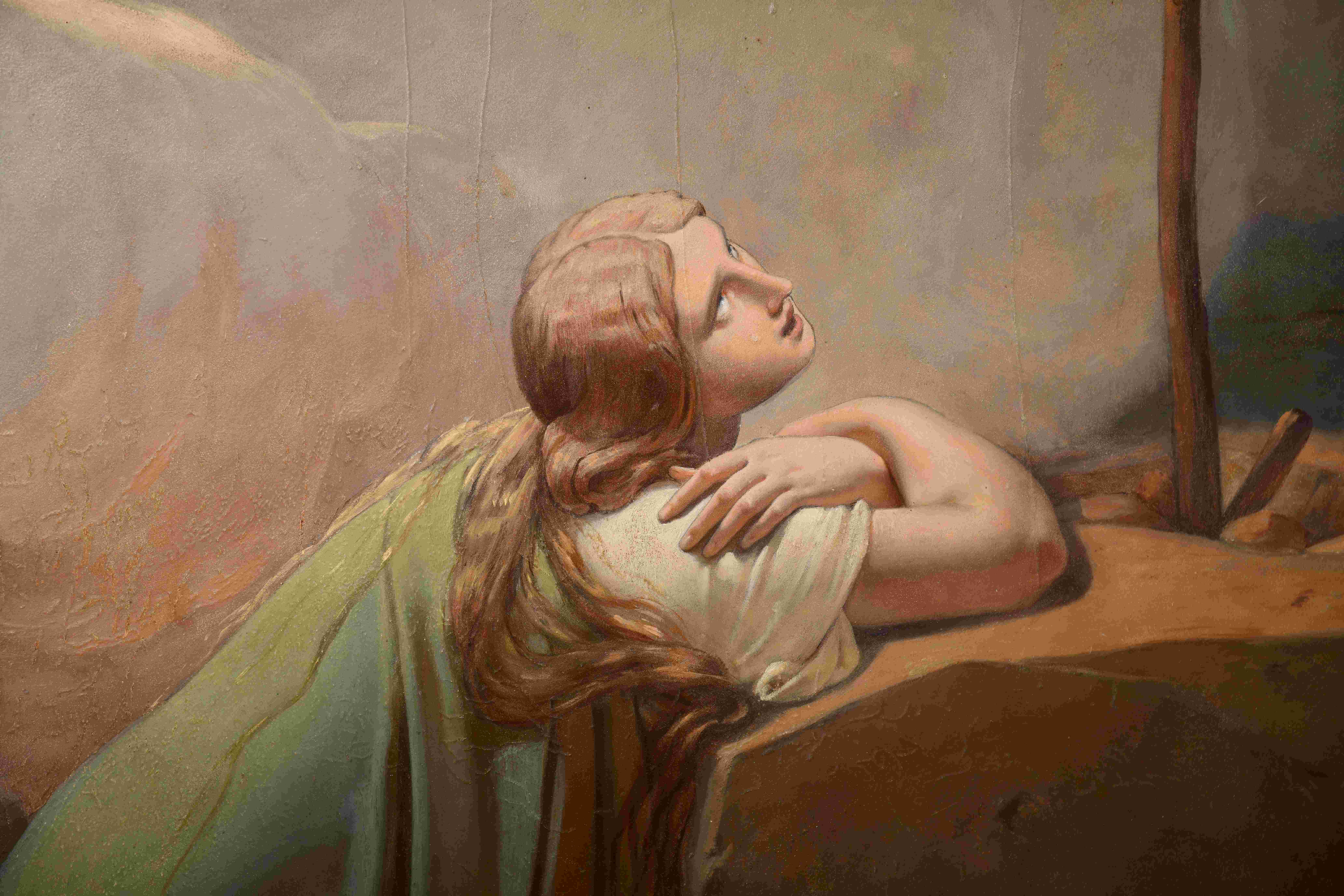
Détails du "Repentir de Madeleine" (paroi droite) peints par Jean-Gilbert Murat en 1844
Crédit photo :
Crédit photo : Jean-Marc Moser / Ville de Paris

Fin de la restauration du tableau à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / Ville de Paris

Vitrail d’ Édouard-Amédée Didron
Crédit photo :
Crédit photo : Jean-Marc Moser / Ville de Paris
Jean
Gilbert Murat (1807-1863) reçoit
la commande de ce décor en 1844. Murat
réalise ses peintures à l’huile et à la cire sur enduit. Cette technique est
très utilisée dans les décors des églises parisiennes au XIXe
siècle. Les propriétés hydrophobes de la cire (elle repousse l’eau) ainsi que
sa matité expliquent son succès. Les peintures se rapprochent ainsi, par leur
aspect velouté et mat, de celles de l’Antiquité.
À côté des peintures de Murat, le vitrail d’Edouard Amédée Didron (1836-1902) est magnifique, à l'instar d'une Madeleine à la beauté remarquable et
richement vêtue.
Après la restauration de 1941 documentée par les archives, d’autres
interventions ont eu lieu mais aucune n’a eu lieu sur l’ensemble du décor. Les peintures ont été nettoyées, les parties sculptées ont fait l'objet d'un travail singulier et un éclairage vient magnifier l'ensemble.
À l'extérieur, tout comme la chapelle Saint-Joseph, des travaux ont été réalisés
sur les joints de pierre, repris quand cela s’est avéré nécessaire, sur les
remplages mais également sur les corniches sculptées.
La chapelle Sainte-Geneviève

Chapelle Sainte-Geneviève, Émile Hirsch, Geneviève rendant la vue à sa mère, après restauration.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris
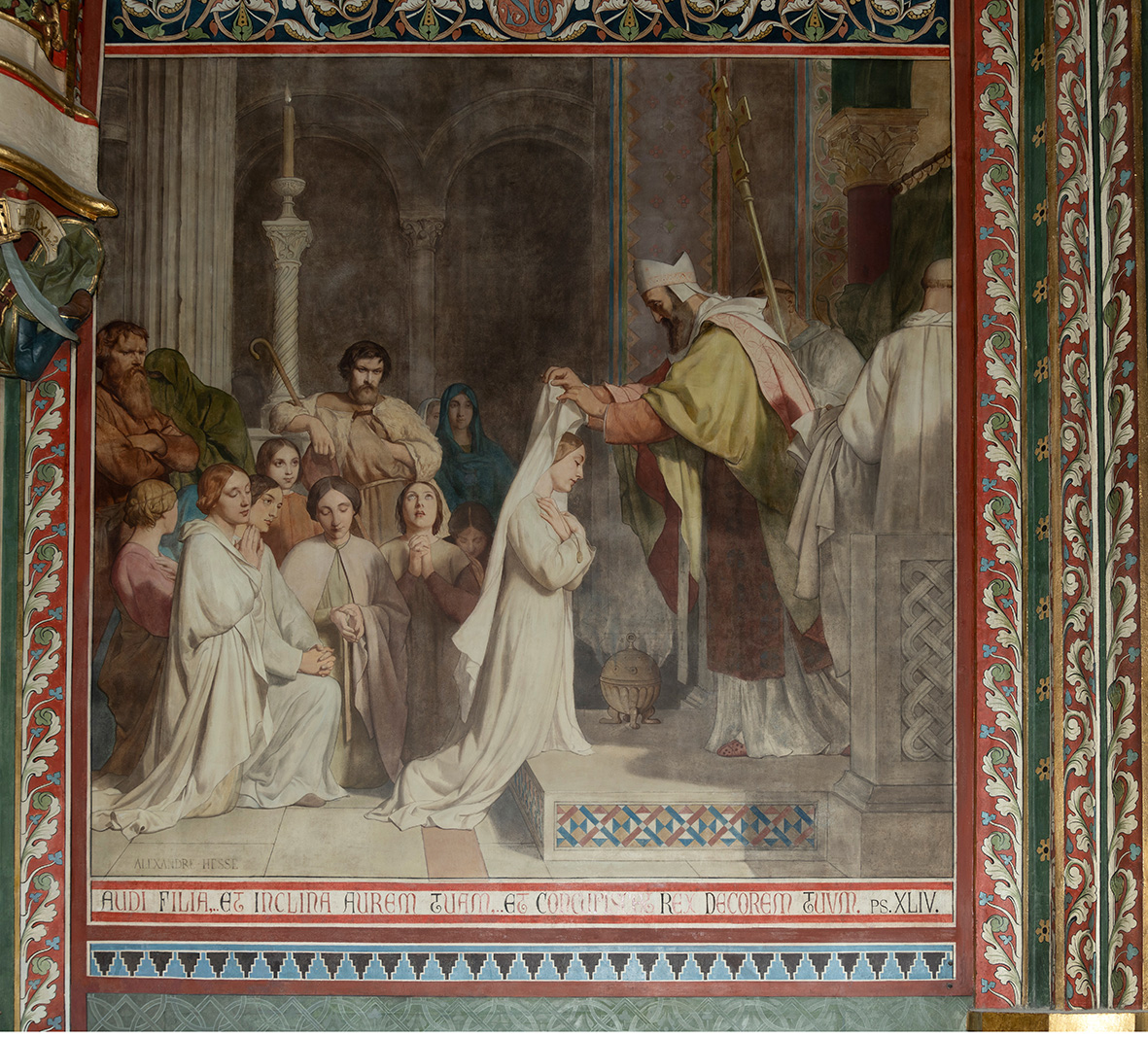
Consécration de sainte Geneviève par l'évêque Germain.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Sainte Geneviève en prière.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Sainte---Geneviève distribuant du pain aux pauvres.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Le miracle des Ardents.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris
Le chantier de la chapelle Sainte-Geneviève, entre 2020 et 2021, a inauguré l’importante entreprise de restauration des décors peints de l’église Saint-Séverin.
L’attention des restaurateurs s’est portée en premier lieu sur les peintures murales d’Alexandre Hesse (1806-1879) réalisées entre 1850 et 1852 en s’inspirant de la tradition des maîtres italiens du XVe siècle et des techniques de peinture murale afin de s’approcher du rendu de la fresque, un hommage au modèle incontournable de l’Antiquité et des maîtres de la Renaissance (Raphaël, Michel-Ange).
Le décor ne se réduit pas aux peintures murales. La restauration a également concerné le vitrail (réalisé par Émile Hirsch en 1876), les parties sculptées (sculpture de sainte Geneviève en plâtre peint et culots sculptés datés du XVIe siècle), la barrière, l’autel et le parquet. L’ensemble du décor est par ailleurs magnifié par un nouvel éclairage.
La chapelle Saint-Jean

Chapelle Saint-Jean, Hippolyte Flandrin, Le Christ (détail de la Cène), en cours de restauration.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

La vocation de saint Jean.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Saint Jean rédigeant l’Apocalypse sur l’île de Patmos, en cours de restauration.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris
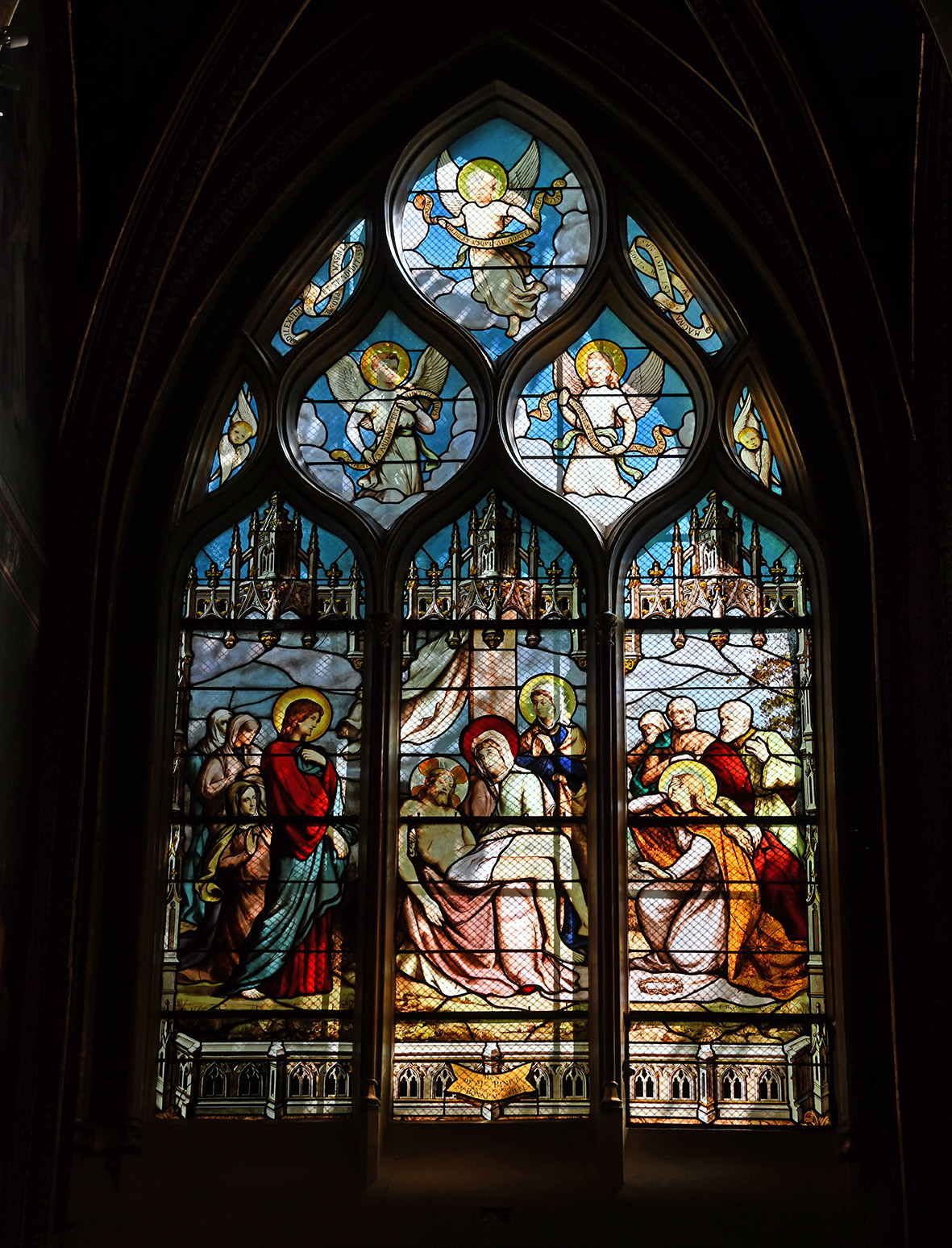
La Descente de la Croix, d'Émile Hirsch.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

La Cène, d'Hippolyte Flandrin.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris
La chapelle Saint-Jean accueille la première œuvre monumentale du peintre Hippolyte Flandrin (1809-1864) et est la première chapelle à recevoir un décor peint au XIXe siècle. Les peintures sont signées et datées de 1840. Quatre épisodes de la vie de saint Jean sont représentés dans la chapelle : La Cène, Saint Jean rédigeant l’Apocalypse sur l’île de Patmos, Le martyre du saint plongé dans l’eau bouillante et La vocation de saint Jean. La Cène
a retenu l’attention dès sa conception : la pureté des lignes, le geste
d’abandon de Jean, l’absence suggérée de Judas et l’harmonie qui s’en dégage malgré la gravité du moment en font un chef-d’œuvre de la peinture murale. Cependant, la paroi s’est très vite détériorée sous l’effet d’infiltrations d’eau.
La restauration, menée entre juillet 2021 et juillet 2022, est la seconde intervention globale dans le bas-côté sud de l’église. Elle comprend par ailleurs le vitrail d’Émile Hirsch représentant une Descente de Croix
(1876) et les parties sculptées métalliques. Les soulèvements sont désormais stabilisés, les écailles fixées et les peintures nettoyées.
La chapelle Saint-Séverin

Chapelle Saint-Séverin, Sébastien-Melchior Cornu, la reine Clotilde (détail de saint Séverin, abbé d’Agaune, guérit miraculeusement le roi Clovis), en cours de restauration.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Saint Séverin le Solitaire remet l'habit monastique à Saint-Saint-Saint-Saint-Cloud (à gauche), Saint Séverin, abbé d'Agaune, guérit miraculeusement le roi Clovis (à droite)
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Restauration des voûtes de la chapelle.
Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris

Crédit photo :
Jean-Marc Moser / COARC / Ville de Paris
En 1850, la Ville commande au peintre Sébastien-Melchior Cornu (1804-1870) deux scènes consacrées aux saints Séverin. La chapelle rend en effet hommage à deux saints distincts portant le même prénom ayant vécu à la fin du Ve siècle et au début du VIe siècle. Le premier est un ermite parisien mort vers 555, tandis que le second est un abbé de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune (dans le Valais, Suisse actuelle), mort autour de 507.
La chapelle des deux Saint-Séverin souffrait d’un encrassement très prononcé. Les peintures s'étaient noircies, la saleté résultant en grande partie des fumées des bougies, du chauffage et de la pollution atmosphérique de la ville. De fines fissures étaient présentes sur la voûte, les soubassements étaient également en mauvais état de conservation, la couche picturale y était pulvérulente. Les remontées capillaires ont causé des soulèvements et ont conduit à la perte d’une grande partie du décor essentiellement en partie basse.
Les restaurateurs se sont aussi intéressés aux vitraux de Jean Bazaine (1904-2001) datés de 1964. Huit verrières illustrent l’ensemble des sacrements tout au long du chevet de l’église. Dans cet ensemble, les deux vitraux de la chapelle Saint-Séverin représentent les sacrements de Pénitence et du Sacerdoce. Bazaine s’est associé pour ce projet au maître-verrier Bernard Allain et au peintre-verrier Henri Dechanet. Les verrières ont été nettoyées et leur serrurerie traitée.
La restauration, menée entre octobre 2022 et juin 2023, comprenait également le nettoyage et la réfection des pierres intérieures et extérieures, le nettoyage des parties sculptées et l’éclairage de la chapelle.
Default Confirmation Text
Settings Text Html
Settings Text Html
Votre avis nous intéresse !
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).
Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.